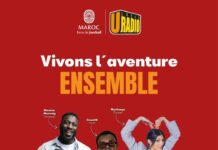Des rapports issus des inspections menées par l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale dans plusieurs communes des régions Casablanca‑Settat, Marrakech‑Safi et Rabat‑Salé‑Kénitra révèlent l’implication de présidents de communes, de conseillers et d’élus influents — anciens ou actuels — dans des litiges collectifs douteux.
Ces inspections ont mis en évidence des pratiques telles que la manipulation de procédures judiciaires, ainsi qu’un laxisme volontaire dans le suivi de procès en cours. On y observe aussi la multiplication d’une « rente judiciaire » : certains élus défendent ou poursuivent leur propre commune dans des affaires judiciaires.
Parmi les constats, un conseiller de la province de Nouaceur s’est vu empêché de briguer la présidence d’une commune après l’éviction de son titulaire, suite à une décision judiciaire.
Les inspections portent sur la période antérieure au lancement de la plateforme électronique « Monazaâ (Litige) », qui vise justement à mieux gérer les contentieux collectifs. Certains élus auraient ignoré les directives du ministère de l’Intérieur (circulaire D/747) les obligeant à informer les conseils communaux des recours intentés contre la commune ou au nom de celle-ci, lors de la première session suivante.
De même, plusieurs présidents de communes n’auraient pas respecté les instructions de leurs walis ou gouverneurs concernant les contrats passés avec des avocats : ils ne les auraient ni actualisés ni fait parvenir aux autorités supérieures, entraînant des dépenses judiciaires élevées et des jugements financiers lourds pour certaines communes.
La loi organique impose pourtant aux élus territoriaux la protection des intérêts des collectivités en cas de litige. En cas de manquement, leur responsabilité est engagée, notamment selon les principes de contrôle administratif et de reddition des comptes (articles 64‑67 des lois organiques régissant régions, préfectures/provinces et communes).
Les inspecteurs ont aussi relevé des cas de collusion interne : des documents montrent des échanges d’intérêts entre certains responsables communaux et les parties adverses, y compris d’anciens élus ou conseillers. Le ministère de l’Intérieur avait déjà estimé que l’augmentation du nombre de condamnations des communes ne s’explique pas seulement par les tribunaux, mais aussi par des complicités internes.