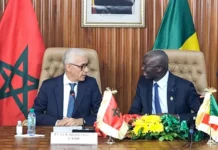À l’approche des élections de 2026, les électeurs marocains montrent un changement notable dans leurs choix politiques, passant des fidélités idéologiques traditionnelles à une approche plus pragmatique, centrée sur les opportunités réelles et l’évaluation concrète des performances des acteurs politiques.
Une étude prospective menée par le Centre Al-Moachar pour les études et recherches révèle que les clivages classiques – droite/gauche, conservateurs/progressistes – perdent de leur influence, tandis que le rôle des facteurs socio-économiques et générationnels prend de l’importance, comme en témoignent les résultats des élections de 2021 et la réorganisation qui a suivi de la scène partisane.
Le “vote utilitaire” devient le mode dominant, les électeurs prenant leurs décisions sur la base de bilans concrets ou de promesses mesurables, plutôt que sur l’adhésion à un projet idéologique global.
Cette évolution s’explique notamment par l’élargissement de la classe moyenne, l’élévation du niveau d’éducation, la montée en puissance des médias numériques, ainsi que le déclin de l’influence symbolique des partis traditionnels. Tout cela rend le choix électoral plus sélectif et moins ancré dans des fidélités stables.
L’étude souligne aussi la hausse du nombre d’électeurs “fluctuants”, qui prennent leur décision dans les derniers jours de la campagne, représentant environ 45 % des votants, ce qui complique davantage les stratégies électorales.
Le rapport indique que la confiance dans les partis politiques ne dépasse pas 13 %, favorisant un vote sanction plutôt qu’un soutien clair à des programmes définis.
L’impact croissant des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube) dans la formation des opinions, notamment chez les jeunes, contraste avec le recul de l’influence des meetings et des rencontres directes.
Face à ce nouveau contexte, l’étude appelle les partis à repenser leurs stratégies de communication pour mieux s’adapter à ces transformations.
Elle note également l’émergence de nouveaux visages politiques hors des structures traditionnelles, souvent porteurs d’un capital social ou professionnel, ce qui pose des défis en termes de coordination et d’harmonisation des programmes au sein des institutions élues.
Une partie des jeunes considère que voter ne change rien à la réalité, signe d’une crise de confiance plus profonde dans le processus démocratique.
Enfin, l’étude qualifie les élections de 2026 “d’épreuve de confiance” plus que d’une simple compétition pour les sièges, soulignant que le principal défi est de reconstruire un lien de confiance entre citoyens et institutions, grâce à des programmes réalisables et des résultats concrets, pour passer d’une “logique d’opportunité” à une “logique de projet” durable et stable.